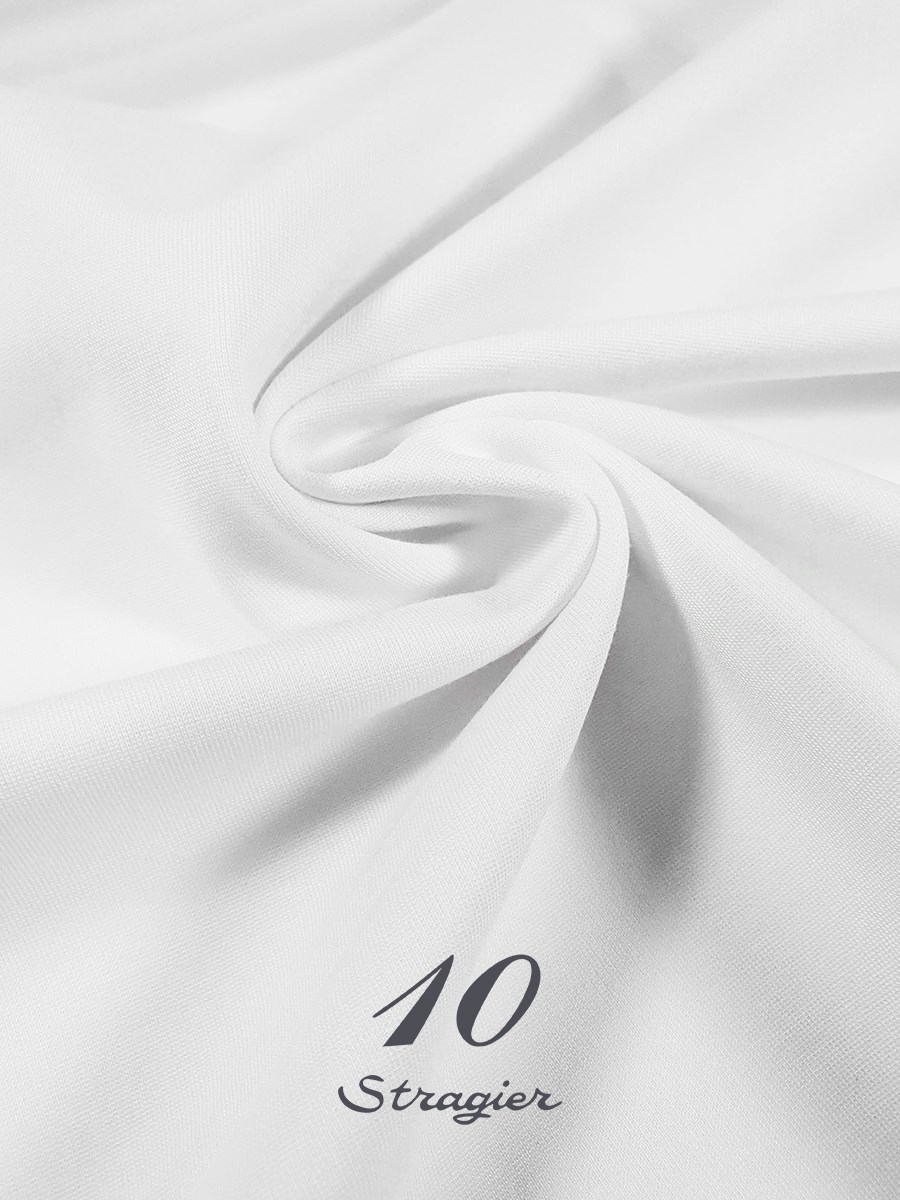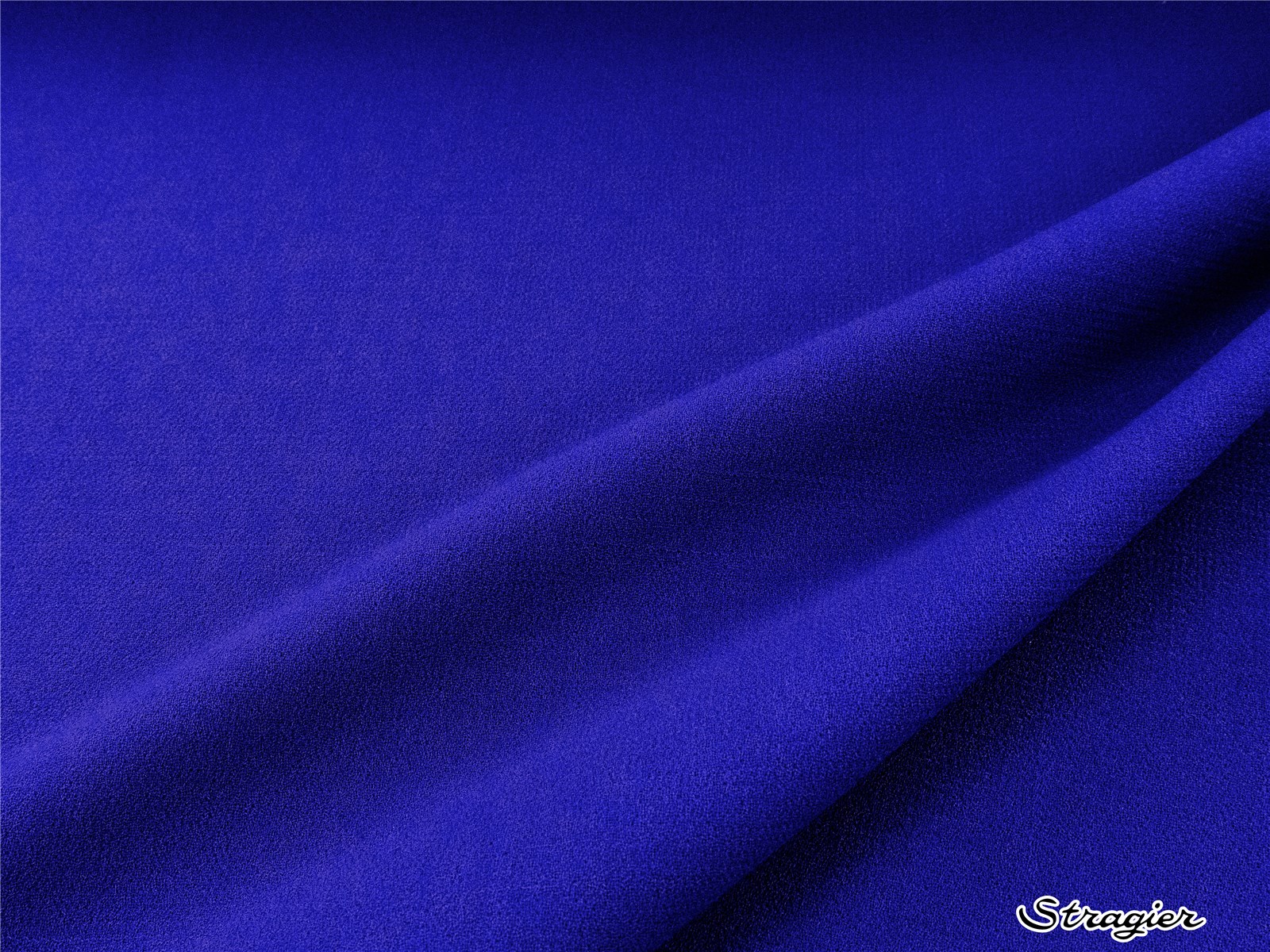La mode, loin de se limiter à des tendances éphémères, trouve parfois son souffle dans des horizons insoupçonnés.
Plus qu’un simple vêtement, une robe peut devenir une fenêtre sur l’imaginaire, un reflet de l’art. Quand les peintres inspirent les couturiers, les frontières entre les deux mondes s’estompent. Une toile devient alors le point de départ d’une silhouette, un tableau prend corps dans le drapé du tissu.
Ces robes, nées de la collaboration entre créateurs et artistes, nous rappellent que la mode, à son plus haut niveau, est une forme d’expression aussi libre et aussi puissante que celle d’un pinceau sur une toile.